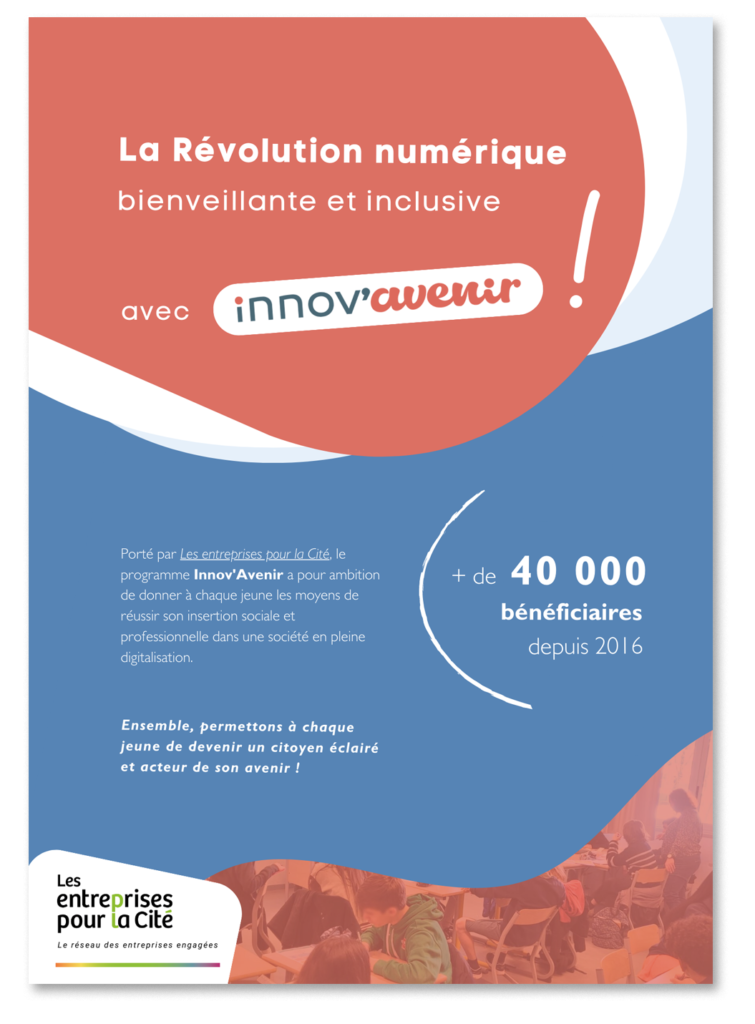ENGAGEZ-VOUS AUPRÈS DES JEUNES AVEC

Un programme d'inclusion numérique
Innov’Avenir est un programme d’inclusion numérique dont l’ambition est d’accompagner les jeunes dans leur projection professionnelle en les aidant à consolider une culture numérique dans une société en profonde mutation. Innov’Avenir favorise l’inclusion numérique en :
– Dotant les jeunes des territoires fragiles des clés de compréhension d’un environnement en mutation
– Elargissant leurs horizons professionnels

Depuis 2016
Modalités
Tout au long de l’année scolaire, Innov’Avenir propose différentes actions en classe ou en entreprise, pour mettre en contact les jeunes de territoires fragiles avec des professionnels d’horizons variés.
Public cible :
• élèves de collèges en zone d’éducation prioritaire ou QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) et lycées des territoires enclavés
• jeunes adultes
Engagez-vous à nos côtés !
Entreprises ou professionnels de l’éducation : rejoignez notre programme pour donner à chaque jeune les clés de la réussite dans un monde en constante évolution numérique ! Contribuez à l’épanouissement des jeunes talents, à leur insertion professionnelle et sociale, et à l’avènement d’une société plus inclusive et numériquement compétente.

A chacun selon ses envies et disponibilités !
Découverte
professionnelle
Un binôme de pros d’entreprise anime des séances de découverte professionnelle dans une classe. Le but des séances est de permettre aux jeunes de mieux se connaitre pour mieux s’orienter, découvrir des métiers et comprendre les codes du monde du travail.
Sessions de 2 heures
Culture
Numérique
Des ateliers pour aider les jeunes à développer leur esprit critique, comprendre la transformation digitale, adopter des comportements responsables sur internet et s’engager au travers du numérique.
Sessions de 2 heures
Grand Format
Les actions Grand Format sont organisées en partenariat avec une des entreprises participantes au programme Innov’Avenir. Elles ont lieu dans les locaux de l’entreprise ou d’une structure partenaire afin de permettre aux jeunes de découvrir le quotidien des collaborateurs et collaboratrices.
Durée de l’action :
2 à 8 heures
Témoignages
C’était plutôt bien personnellement car ça m’a aidé à me « découvrir ». Merci aux intervenants d’avoir pris sur leurs temps de travail pour nous donner des conseils et de nous chercher :)) !
Une élève de 5e C - Collège Auguste Delaune
J'étais vraiment dans la transmission par rapport à ces jeunes. L'idée c'était d'ouvrir pour eux les champs des possibles et aussi d'apprendre de leur part quels étaient les freins qui les empêchait de réfléchir ou de penser accéder à ce type de métier.
Volontaire d’entreprise engagée de Capgemini
J’ai trouvé que ça a sûrement aidé des personnes dans la classe qui n’ont pas d’idées pour leur avenir. Moi comme je sais déjà ce que je vais faire, ça m’a donné encore plus de la confiance pour réussir à atteindre mon objectif et je trouve aussi qu’il faut plus en parler en classe car c’est très important pour nous tous. Merci encore pour cette session ! ;)
Une élève de 5e
Une superbe expérience, pour les jeunes participants comme pour nous (les "experts chenus"). J'ai appris plein de choses sur cette sessions (ou en tout cas confirmé un certain nombre d'intuitions)...
- j'ai fait nombre d"ateliers dont les participants étaient des professionnels du Digital, et dont le résultat était beaucoup moins convainquant que ce que ces 8 groupes de jeunes ont pu inventer et produire en une journée !
- J'ai été bluffé par la pertinence des idées présentées, en fait j'aimerais que ces applications existent !
...Si on laisse les jeunes prendre en main un certain nombre de problèmes de société, il y a des chances pour que les solutions soient meilleures que ce qu'on chercherait à leur imposer , ou que les usines à gaz et les collections de numéros verts chères à nos institutions.
- Et sinon la vraie joie que j'éprouve toujours à transmettre, à donner de l'assurance, et à- comble de bonheur, voir des potentiels s'accomplir.
En montagne comme en design Thinking, emmener quelques uns la où ils ne se croyaient pas capable d'aller, et les voir revenir en vainqueurs, avec la banane, c'est le kiff !
Collaborateur
Le fait d'avoir des partenaires du monde de l'entreprise qui viennent expliquer comment ça fonctionne... Ça a rendu les élèves hyper motivés. [...] Depuis des années on travaille avec plaisir avec Innov'Avenir car on voit l'impact positif que ça a sur nos élèves !
Enseignant au collège
J'ai appris ce qu'était un stéréotype, j'ai aussi pris conscience qu'il n'y avait pas de métier réservé aux hommes ou aux femmes. Merci beaucoup !
Une élève de 4e
La session était enrichissante et m’a permis une meilleure approche lors d’un entretien.
Un élève de 3e
L'équipe Innov'Avenir
Partenaires du programme




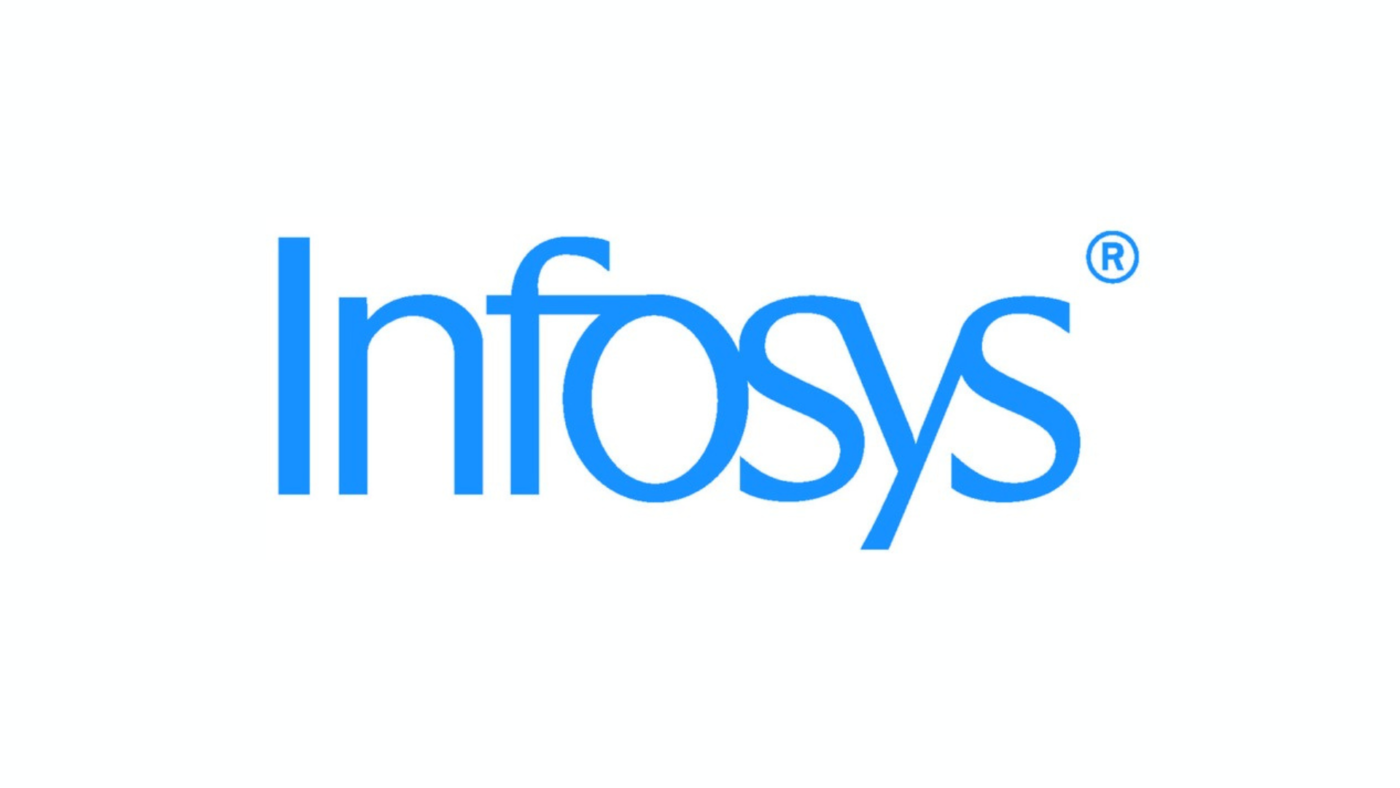
Contact
Envie de vous engager pour les jeunes
et de promouvoir l’égalité des chances ?
N’hésitez pas à nous contacter !